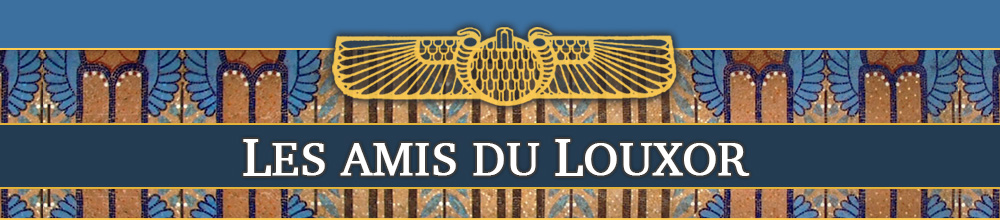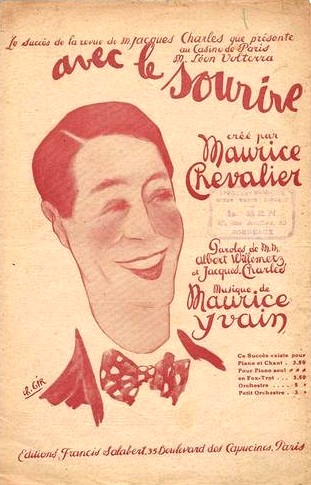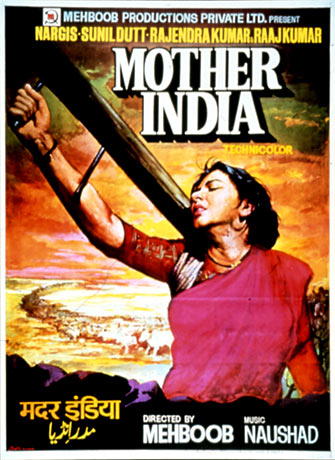Rencontre au Balzac avec Jean-Jacques Schpoliansky et Virginie Champion-Terreaux
À l’horizon de 2013, le Louxor s’ajoutera à la liste des cinémas parisiens. Certains n’ont pas manqué de s’interroger : les salles indépendantes des grands circuits ont-elles encore un avenir dans une ville où l’offre culturelle est déjà aussi riche ? Nous avons souhaité demander leur avis aux premiers intéressés, les exploitants eux-mêmes, à la lumière de leur expérience personnelle d’acteurs de terrain et de militants d’un cinéma vivant et de qualité. Nous commençons par Jean-Jacques Schpoliansky, qui anime le Balzac depuis 1973. Il nous a reçus en compagnie de Virginie Champion-Terreaux, sa collaboratrice depuis 1994.
Pouvez-vous nous rappeler votre parcours ?
Jean-Jacques Schpoliansky : J’étais « un cancre », d’abord ! Je suis bac-1… À la suite d’un accident survenu justement au moment du bac, j’ai dû garder le lit pendant un an. Ensuite, en 1965, je suis entré comme stagiaire chez UGC et j’ai petit à petit appris ce qu’était l’exploitation, puis la programmation. Car en 1967, j’ai été chargé de la programmation en milieu universitaire. On ne parlait pas encore d’Art et Essai mais j’organisais par exemple des semaines du cinéma brésilien ou des cinémas de l’Est, etc. dans des salles situées sur les campus, comme les cinémas Ariel de Mont-Saint-Aignan ou de Grenoble.
En 1969, la direction d’UGC m’a confié la direction de trois salles à Tours, les Majestic, Palace et Cyrano ; j’avais 25 ans ; j’y suis resté un an. Puis j’ai été « débauché » par un producteur, et pas des moindres, puisqu’il s’agissait de Serge Silberman qui avait besoin d’un assistant. J’ai ainsi participé à la production de deux films, Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel, et La course du lièvre à travers les champs de René Clément, et je m’apprêtais à travailler à un troisième (À nous les petites anglaises).
Mais mon père est décédé en 1973 et je lui ai succédé au cinéma Balzac.

Jean-Jacques Schpoliansky présente régulièrement les films aux spectateurs
Le Balzac était une entreprise familiale ?
Il a été créé par mon grand-père en 1935. C’était un cinéma de style Art-Déco. Il y avait un hall de 200 m² avec une conque marine, les bureaux de mon grand-père qui faisaient 100 m², et une salle de 630 places.
Avant la guerre, Le Balzac programmait des films américains : Frank Borzage, John Ford, tous les films de Shirley Temple ; en majorité les grands films de la 20th Century Fox. Après la guerre, ce fut le tour du cinéma français. J’ai tous ces films en mémoire : Jour de Fête, Les Vacances de M. Hulot, La Ronde, Casque d’or, Gervaise, À bout de souffle, Les Tontons flingueurs, etc. jusqu’à La piscine de Jacques Deray dont Le Balzac, qui avait déjà cette pratique, avait organisé l’avant-première en présence des acteurs.
Mais il y avait eu des bouleversements dans l’économie du cinéma, que mon père n’avait pas vus venir. En 1971, UGC, au départ une petite société d’économie mixte (État/privé), a été vendue à d’importants exploitants parisiens privés et est devenue une grosse « major ».
Dans le quartier des Champs-Élysées, avec la disparition des indépendants, mon père s’est retrouvé isolé. Lorsque j’ai repris Le Balzac en 73, j’étais donc face à une seule salle et sans films.
Pourquoi « sans films » ?
À partir du moment où les autres indépendants avaient disparu, on ne pouvait plus prétendre avoir le moindre film. Seul, je ne faisais pas le poids face aux grands groupes qui captaient tous les films.Je devais donc poursuivre plusieurs objectifs :
– Arrêter l’hémorragie : ne plus dépendre d’un seul film ! Pour cela, il fallait intervenir sur le cadre. J’ai créé deux salles supplémentaires, à partir du hall et des bureaux de mon grand-père, sans perdre un mm3 du Balzac ! Avec trois salles, je pouvais augmenter le nombre et la rotation des films.